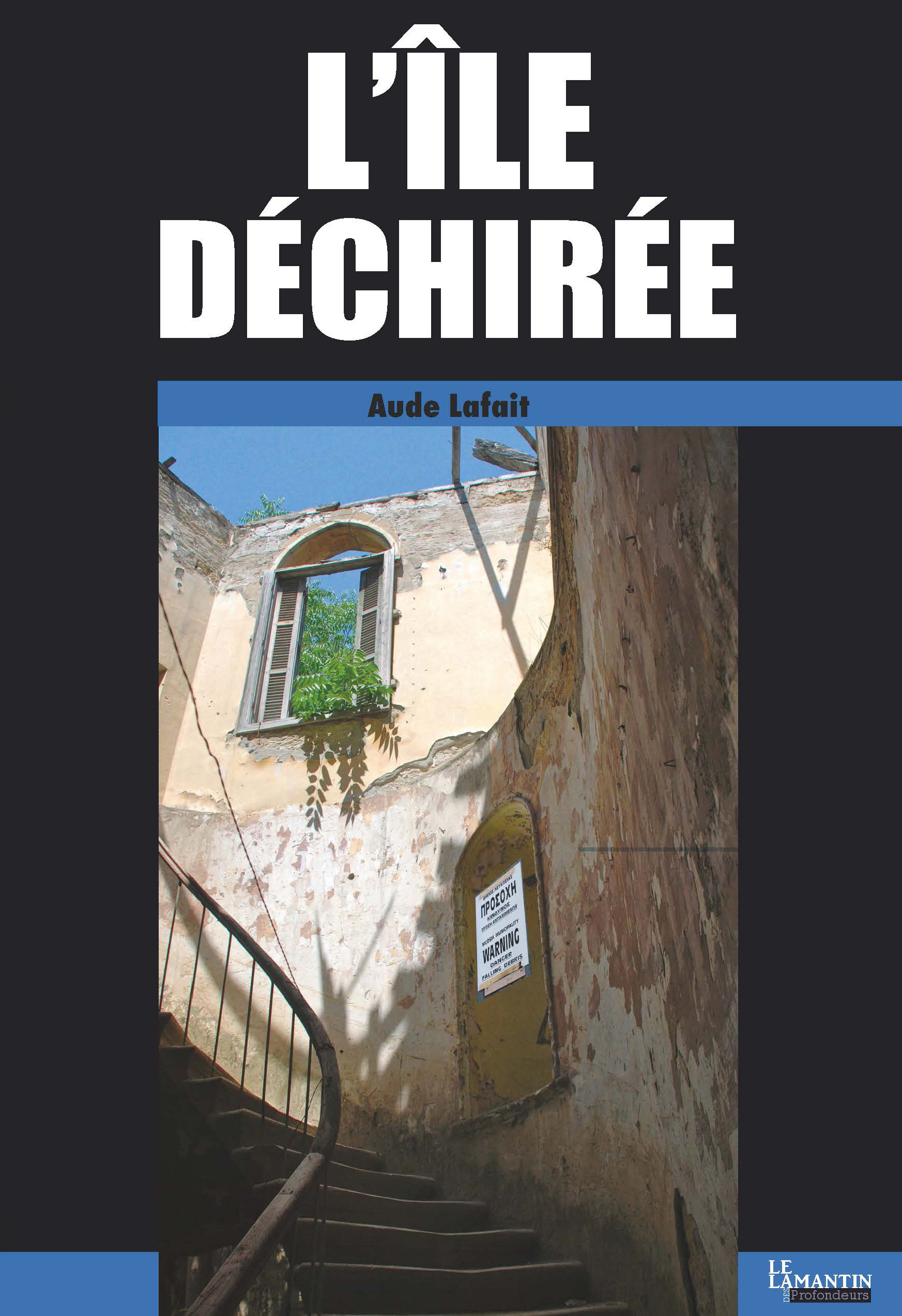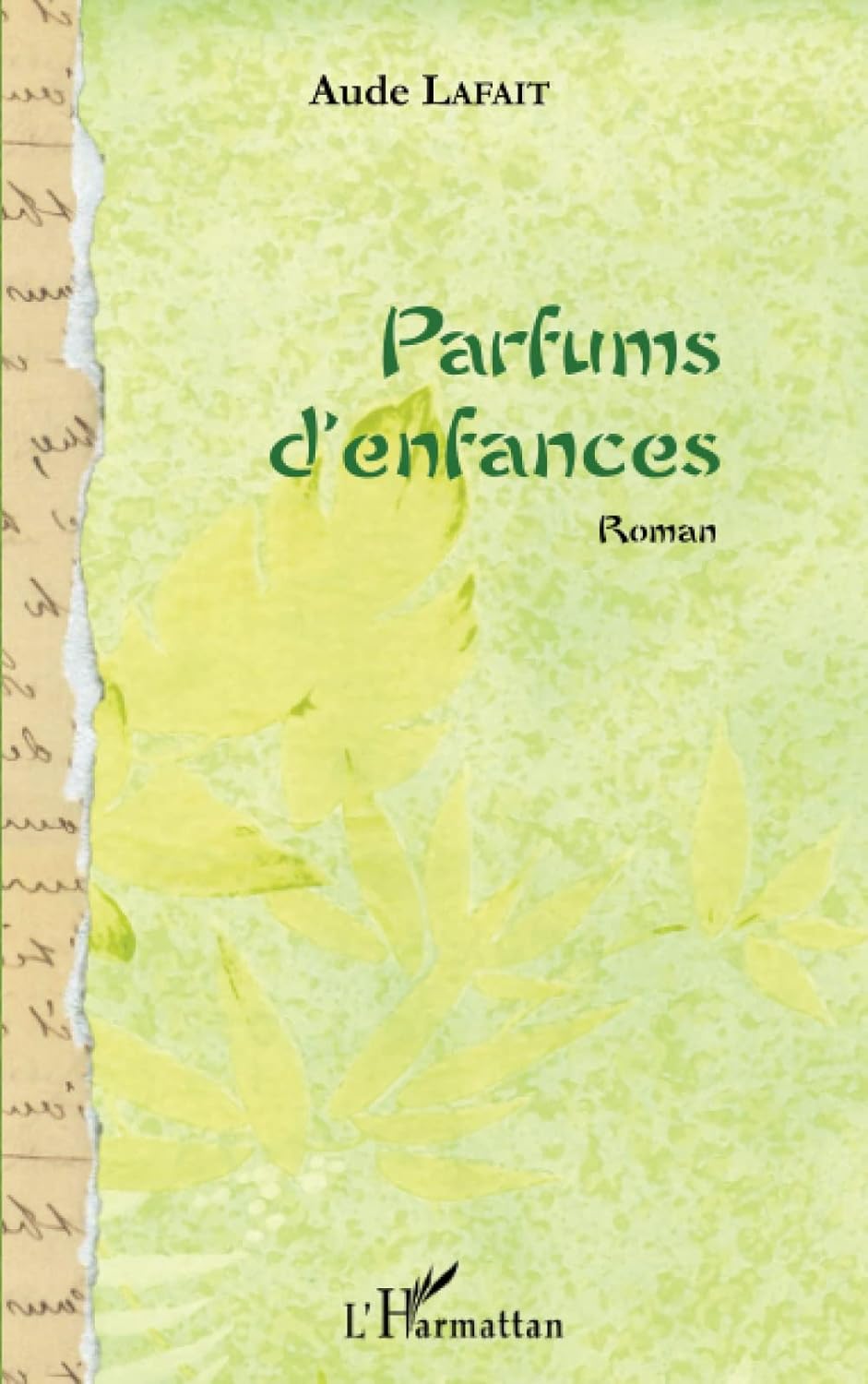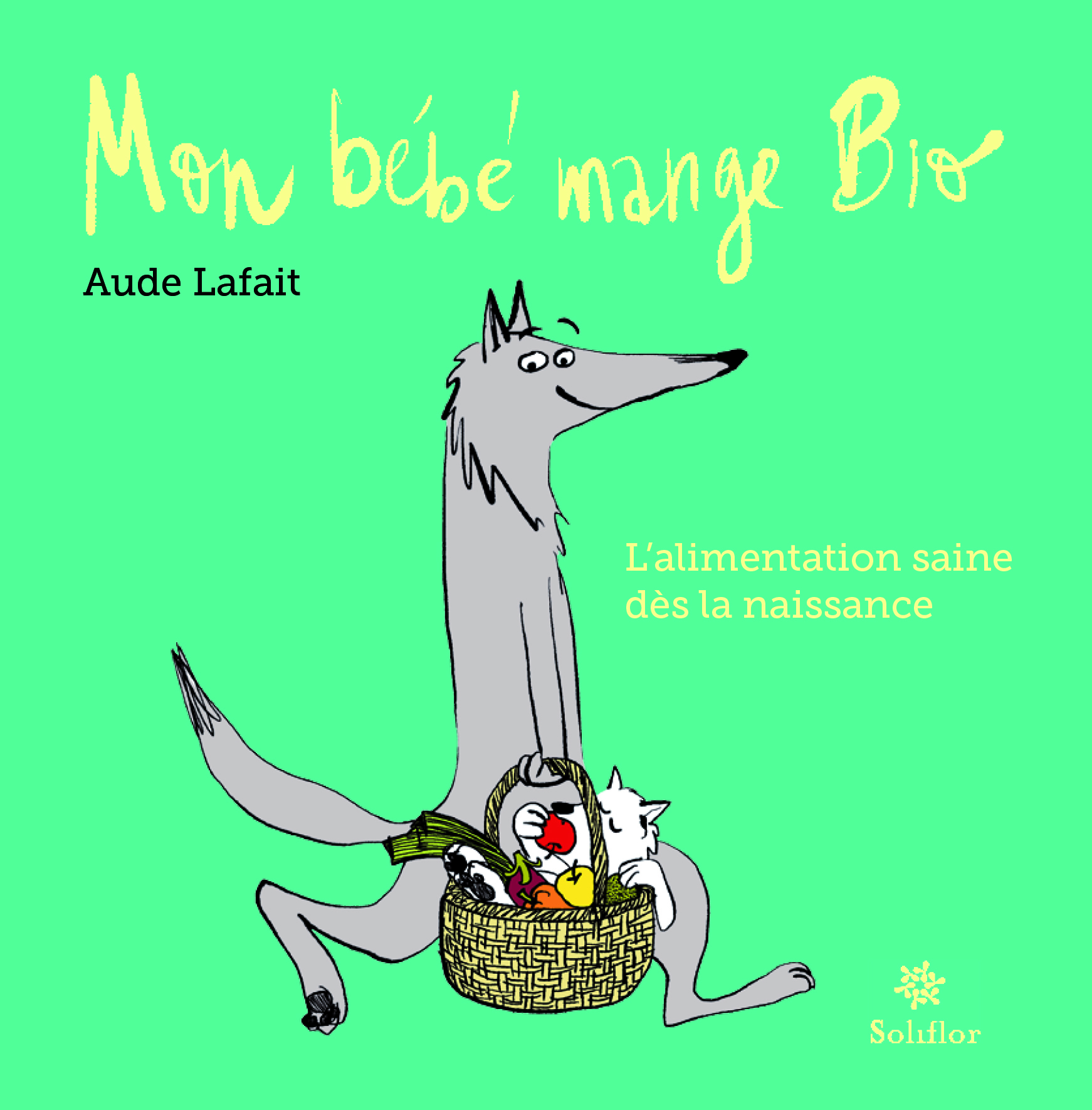Tisser des histoires,
révéler les vôtres.
Découvrez mes romans, mes écrits, mes formations, mes photographies.
Explorer mes livres

Mon parcours
Auteure, voyageuse et passeuse de mots. Nourrie par des études de littérature et dix ans d'enseignement du français langue étrangère à travers le monde, Aude Lafait explore dans ses romans et ses textes les thèmes du voyage, de l'intime et des racines.
Aujourd'hui, forte de son expérience de coach littéraire formée à l'école d'écriture Aleph à Paris et de la publication de six ouvrages, elle se consacre à transmettre ce qu'elle sait de plus précieux : l'art de trouver sa voix et de donner vie aux histoires que l'on porte en soi.
Mes publications
Découvrez mes livres et voyagez au cœur de mes récits.