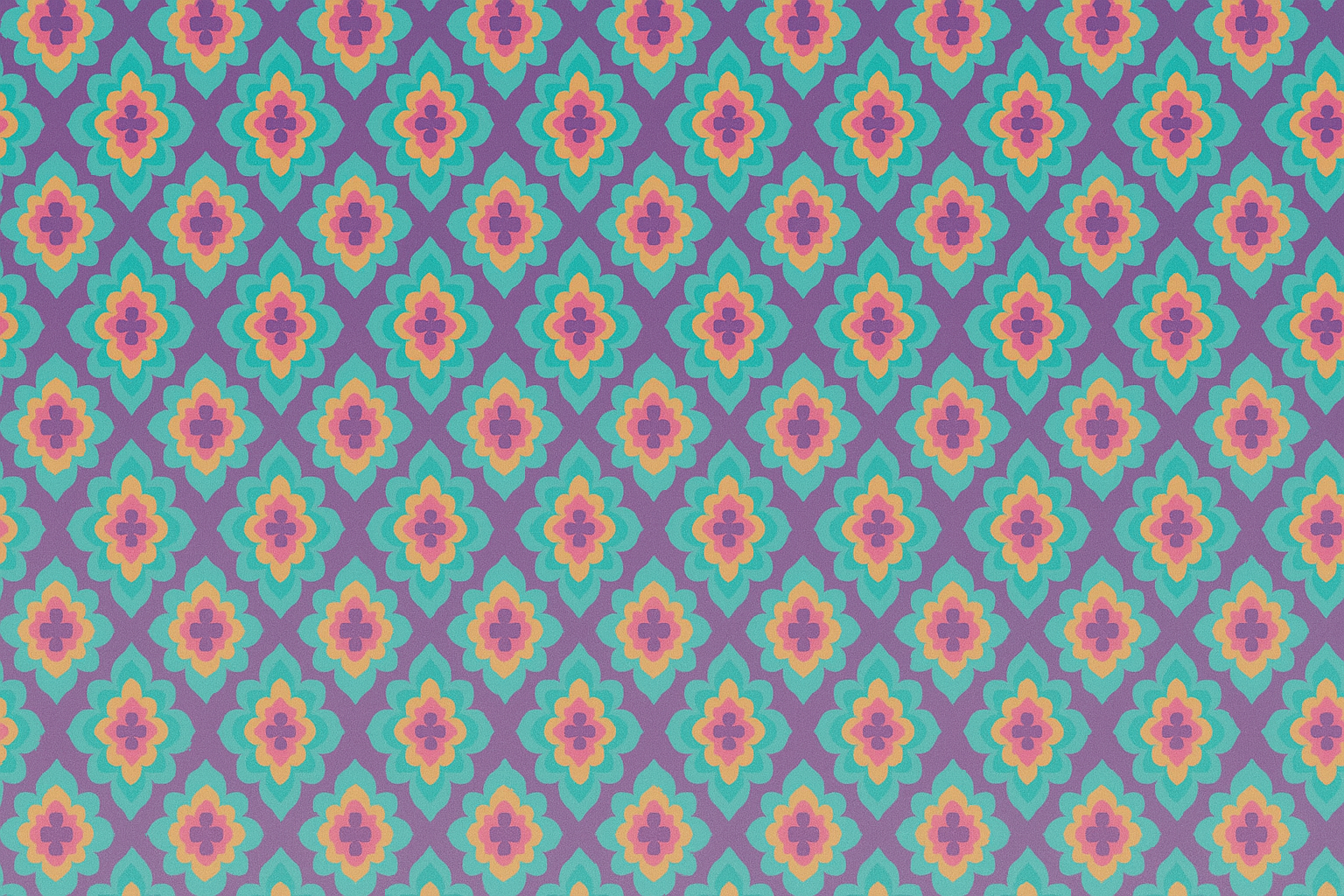Écriture
Greenline
Aude Lafait, auteur et Annick Mertens, photographe, ont vécu à Chypre entre 2010 et 2012. Leurs déambulations dans la ville de Nicosie ont donné naissance à cette exposition de photographies et de tex...
Aude Lafait, auteur et Annick Mertens, photographe, ont vécu à Chypre entre 2010 et 2012. Leurs déambulations dans la ville de Nicosie ont donné naissance à cette exposition de photographies et de textes présentée à Pêle-Mêle, Bruxelles, en 2014. 
 Il y a toutes ces fenêtres éteintes, cette absence collée dans la peinture. Il y a la mort comme un souffle passé sur la ville en 1974. Nicosie, tes ruelles anciennes, tes odeurs de moisi, tes bâtisses fières dans le ciel sans pluie. Quelque chose d'indicible, cette nostalgie, comme si la ville attendait encore le retour de ses disparus. Le présent est comme figé dans le passé de cet été là , quand les troupes turques ont envahi le nord de Chypre. Les traces de balles sur les vieilles pierres, les bidons d'essence peints en bleu et blanc. Le vert militaire. Il y a ce barbier, Christo, 78 ans, il n'a pas bougé depuis quatre ou cinq décennies et ce matin il a posé devant l'appareil photo, fier, derrière lui son évier blanc à l'effigie de son histoire. De quoi te souviens-tu de 1974 ? Son sourire gourmand d'une confiance encore collée aux lèvres. Que deviendra sa boutique dans dix ans ? Dernière, aux portes de l'oubli. Je ne sais pas ce qui m'attire ici, cette ville me fascine. Quelque chose m'appelle, écris, écris ça, maintenant. Serait-ce pour empêcher le temps de filer, pour fixer ce qui reste, pour comprendre comment le destin de deux peuples peut ainsi basculer en quelques heures ? Ce pays s'échappe, Nicosie se désagrège, grains de sable trop fin, trop blanc, entre mes doigts. Je suis aveuglée par la lumière des matins, la liquidité du ciel. Comment vivre à côté de la Green Line ? Comment vivre comme si de rien n'était ? Tout semble figé, immobile. Parfois une vieille carcasse de voiture en bord de rue dont les pneus n'ont plus frôlé le bitume depuis trente-huit ans.
Il y a toutes ces fenêtres éteintes, cette absence collée dans la peinture. Il y a la mort comme un souffle passé sur la ville en 1974. Nicosie, tes ruelles anciennes, tes odeurs de moisi, tes bâtisses fières dans le ciel sans pluie. Quelque chose d'indicible, cette nostalgie, comme si la ville attendait encore le retour de ses disparus. Le présent est comme figé dans le passé de cet été là , quand les troupes turques ont envahi le nord de Chypre. Les traces de balles sur les vieilles pierres, les bidons d'essence peints en bleu et blanc. Le vert militaire. Il y a ce barbier, Christo, 78 ans, il n'a pas bougé depuis quatre ou cinq décennies et ce matin il a posé devant l'appareil photo, fier, derrière lui son évier blanc à l'effigie de son histoire. De quoi te souviens-tu de 1974 ? Son sourire gourmand d'une confiance encore collée aux lèvres. Que deviendra sa boutique dans dix ans ? Dernière, aux portes de l'oubli. Je ne sais pas ce qui m'attire ici, cette ville me fascine. Quelque chose m'appelle, écris, écris ça, maintenant. Serait-ce pour empêcher le temps de filer, pour fixer ce qui reste, pour comprendre comment le destin de deux peuples peut ainsi basculer en quelques heures ? Ce pays s'échappe, Nicosie se désagrège, grains de sable trop fin, trop blanc, entre mes doigts. Je suis aveuglée par la lumière des matins, la liquidité du ciel. Comment vivre à côté de la Green Line ? Comment vivre comme si de rien n'était ? Tout semble figé, immobile. Parfois une vieille carcasse de voiture en bord de rue dont les pneus n'ont plus frôlé le bitume depuis trente-huit ans.
 Tels deux chats de gouttière à la tombée de la nuit, Annick et moi nous faufilons entre les sacs de sable et les bidons remplis de béton de la Green Line. Il fait tiède, nous sommes en t-shirt, déjà plus de trente degrés aux premiers jours de mai. Silencieuses. Ne pas nous faire repérer. Le moindre craquement de porte ou bruissement de paroles échangées me fait sursauter. Nous gagnons les abords des points d'observation. Ici c'est un territoire de silence. Dans l'épaisseur morbide de l'air je tente de sentir, de comprendre ce que cela peut être de toucher, de longer cette ligne depuis plus de trente huit ans avec des bottes kaki et un fusil à l'épaule. Juste un peu plus loin, de l'autre côté de cette fausse frontière, de cette séparation improvisée dans l'urgence, les militaires veillent. Quelles sont leurs blagues pour tromper l'attente et la fatigue ? Y a-t-il encore des questions dans leurs yeux rivés sur le sud de Nicosie ? Qu'est-ce que dresser un mur veut dire ? Je pourrais m'extraire de ce boyau clandestin et me hisser sur cette ligne. Lentement, funambule, je glisserais sur la pliure point de mire des deux regards, de là -haut j'apercevrais la mer au nord et la mer au sud. Une île enfin réunie. Une île comme un livre que je referme mais dont il manque la fin.
Tels deux chats de gouttière à la tombée de la nuit, Annick et moi nous faufilons entre les sacs de sable et les bidons remplis de béton de la Green Line. Il fait tiède, nous sommes en t-shirt, déjà plus de trente degrés aux premiers jours de mai. Silencieuses. Ne pas nous faire repérer. Le moindre craquement de porte ou bruissement de paroles échangées me fait sursauter. Nous gagnons les abords des points d'observation. Ici c'est un territoire de silence. Dans l'épaisseur morbide de l'air je tente de sentir, de comprendre ce que cela peut être de toucher, de longer cette ligne depuis plus de trente huit ans avec des bottes kaki et un fusil à l'épaule. Juste un peu plus loin, de l'autre côté de cette fausse frontière, de cette séparation improvisée dans l'urgence, les militaires veillent. Quelles sont leurs blagues pour tromper l'attente et la fatigue ? Y a-t-il encore des questions dans leurs yeux rivés sur le sud de Nicosie ? Qu'est-ce que dresser un mur veut dire ? Je pourrais m'extraire de ce boyau clandestin et me hisser sur cette ligne. Lentement, funambule, je glisserais sur la pliure point de mire des deux regards, de là -haut j'apercevrais la mer au nord et la mer au sud. Une île enfin réunie. Une île comme un livre que je referme mais dont il manque la fin.
 Je m'appelle Hussein Pil, je suis chypriote turc et je viens d'avoir 80 ans. Le 20 juillet 1974 en quelques heures j'ai dû quitter la ville de Paphos où j'ai grandi et où mes enfants sont nés. J'ai dû m'exiler au nord, tout abandonner, ma maison, mes oliviers, mes meubles, mes photos de famille sur les murs, les souvenirs qui avaient poussé partout. Mais moi, j'avais la vie sauve. Ce soir, 22 avril 2003, je suis venu à Nicosie, au bord de la Green Line, avec mon fils Guner, il avait quelques mois quand nous avons dû fuir en 1974. Je lui ai demandé de m'accompagner car demain les autorités ouvriront le premier check point de l'île. Je sais que nous serons des centaines, des milliers peut-être à vouloir retourner sur le lieu de notre vie d'avant. Ce soir malgré mon dos fatigué, je vais dormir dans la voiture et demain je traverserai à pied la Green Line. Je veux être là , un des premiers à mettre le pied de l'autre côté, après vingt-neuf ans, aux aurores demain matin. Qu'est devenue ma maison ? Mes oliviers ont-ils été coupés ? Que reste-t-il des jeux des enfants dans la petite cour défraîchie ? Et la tombe de ma femme au cimetière du village ? C'est comme si l'hier de 1974 n'avait pas pris une ride dans ma tête. « I feel like I'm living a dream » dit-il alors qu'il traverse la Green Line à Ledras Palace.
Je m'appelle Hussein Pil, je suis chypriote turc et je viens d'avoir 80 ans. Le 20 juillet 1974 en quelques heures j'ai dû quitter la ville de Paphos où j'ai grandi et où mes enfants sont nés. J'ai dû m'exiler au nord, tout abandonner, ma maison, mes oliviers, mes meubles, mes photos de famille sur les murs, les souvenirs qui avaient poussé partout. Mais moi, j'avais la vie sauve. Ce soir, 22 avril 2003, je suis venu à Nicosie, au bord de la Green Line, avec mon fils Guner, il avait quelques mois quand nous avons dû fuir en 1974. Je lui ai demandé de m'accompagner car demain les autorités ouvriront le premier check point de l'île. Je sais que nous serons des centaines, des milliers peut-être à vouloir retourner sur le lieu de notre vie d'avant. Ce soir malgré mon dos fatigué, je vais dormir dans la voiture et demain je traverserai à pied la Green Line. Je veux être là , un des premiers à mettre le pied de l'autre côté, après vingt-neuf ans, aux aurores demain matin. Qu'est devenue ma maison ? Mes oliviers ont-ils été coupés ? Que reste-t-il des jeux des enfants dans la petite cour défraîchie ? Et la tombe de ma femme au cimetière du village ? C'est comme si l'hier de 1974 n'avait pas pris une ride dans ma tête. « I feel like I'm living a dream » dit-il alors qu'il traverse la Green Line à Ledras Palace.
 Il y a ces lieux qui vous sautent à la gorge. Ici à Varosha, la vie n'a jamais repris son cours. La ville désertée épouse les contours de Famagusta. Dans les années 70 le paradis balnéaire de la haute société. Suites de luxe réservées trente ans à l'avance. Vue turquoise à perte d'horizon. Varosha en quelques heures a tout perdu. Les courants d'air, trente-huit ans plus tard, la traversent toujours. La population, majoritairement grecque et britannique, a fui pendant l'invasion de 1974. La ville morte est depuis sous contrôle de l'armée turque. Interdiction d'y pénétrer, interdiction de prendre des photos. Seul un groupe très restreint de fonctionnaires de l'ONU peut y accéder. Leur trajectoire est minutieusement dessinée. Chaque regard est contrôlé, en atteste sur la plage la guérite du militaire turc. Varosha c'est le silence du béton mêlé au ressac des vagues. Le linge aux fenêtres, les cages d'escaliers des hôtels prêtes à s'effondrer, les grillages accrochés au bleu du ciel, la béance du vide, l'angoisse des traces profondes de la division d'un monde. Et à côté, juste là , le sable blanc de la plage caresse les jambes des touristes et sous le soleil le cristal des vagues scintille. Trop. Est-ce possible ? Varosha pris en otage, rançon qui se fait attendre et qui remue les esprits. Dans les garages les voitures neuves n'ont jamais roulé, les réfrigérateurs ont pourri, les lits n'ont pas été défaits. Que reste-t-il du passé de chacun ? Un jour les façades emportées par la mer, le vent brisant les dernières vitres, arrachant les derniers souvenirs. Qui un jour oserait revivre ici ?
Il y a ces lieux qui vous sautent à la gorge. Ici à Varosha, la vie n'a jamais repris son cours. La ville désertée épouse les contours de Famagusta. Dans les années 70 le paradis balnéaire de la haute société. Suites de luxe réservées trente ans à l'avance. Vue turquoise à perte d'horizon. Varosha en quelques heures a tout perdu. Les courants d'air, trente-huit ans plus tard, la traversent toujours. La population, majoritairement grecque et britannique, a fui pendant l'invasion de 1974. La ville morte est depuis sous contrôle de l'armée turque. Interdiction d'y pénétrer, interdiction de prendre des photos. Seul un groupe très restreint de fonctionnaires de l'ONU peut y accéder. Leur trajectoire est minutieusement dessinée. Chaque regard est contrôlé, en atteste sur la plage la guérite du militaire turc. Varosha c'est le silence du béton mêlé au ressac des vagues. Le linge aux fenêtres, les cages d'escaliers des hôtels prêtes à s'effondrer, les grillages accrochés au bleu du ciel, la béance du vide, l'angoisse des traces profondes de la division d'un monde. Et à côté, juste là , le sable blanc de la plage caresse les jambes des touristes et sous le soleil le cristal des vagues scintille. Trop. Est-ce possible ? Varosha pris en otage, rançon qui se fait attendre et qui remue les esprits. Dans les garages les voitures neuves n'ont jamais roulé, les réfrigérateurs ont pourri, les lits n'ont pas été défaits. Que reste-t-il du passé de chacun ? Un jour les façades emportées par la mer, le vent brisant les dernières vitres, arrachant les derniers souvenirs. Qui un jour oserait revivre ici ?
 A cette heure encore il fait si chaud L'air colle à sa vieille peau Elle et sa dentelle s'assoient sur le trottoir Elle aime la vie du dehors le soir Il y a du monde presque comme autrefois Je ne suis plus seule tu vois Xenia Sa vie coupée en deux avec la Green Line au milieu Le nord c'était avant c'était avec eux Le sud solitaire l'a recueillie depuis Et ses enfants sont partis ailleurs gagner leur vie En Angleterre En Afrique du sud et à Vancouver Elle entend leur voix parfois Mais ses petits-enfants de là -bas Jamais ne grandiront ici Elle s'attèle malgré tout à recoudre leurs vies Ce soir il fait encore trop chaud De trop de solitude s'assèche sa vieille peau Elle s'installe avec sa chaise sur le trottoir Là où elle aime attendre les bruits du soir. Textes : Aude Lafait Photographies : Annick Mertens.
A cette heure encore il fait si chaud L'air colle à sa vieille peau Elle et sa dentelle s'assoient sur le trottoir Elle aime la vie du dehors le soir Il y a du monde presque comme autrefois Je ne suis plus seule tu vois Xenia Sa vie coupée en deux avec la Green Line au milieu Le nord c'était avant c'était avec eux Le sud solitaire l'a recueillie depuis Et ses enfants sont partis ailleurs gagner leur vie En Angleterre En Afrique du sud et à Vancouver Elle entend leur voix parfois Mais ses petits-enfants de là -bas Jamais ne grandiront ici Elle s'attèle malgré tout à recoudre leurs vies Ce soir il fait encore trop chaud De trop de solitude s'assèche sa vieille peau Elle s'installe avec sa chaise sur le trottoir Là où elle aime attendre les bruits du soir. Textes : Aude Lafait Photographies : Annick Mertens.

- GREENLINE, 2012
- EST-CE QU'ON OUBLIE ?
 Il y a toutes ces fenêtres éteintes, cette absence collée dans la peinture. Il y a la mort comme un souffle passé sur la ville en 1974. Nicosie, tes ruelles anciennes, tes odeurs de moisi, tes bâtisses fières dans le ciel sans pluie. Quelque chose d'indicible, cette nostalgie, comme si la ville attendait encore le retour de ses disparus. Le présent est comme figé dans le passé de cet été là , quand les troupes turques ont envahi le nord de Chypre. Les traces de balles sur les vieilles pierres, les bidons d'essence peints en bleu et blanc. Le vert militaire. Il y a ce barbier, Christo, 78 ans, il n'a pas bougé depuis quatre ou cinq décennies et ce matin il a posé devant l'appareil photo, fier, derrière lui son évier blanc à l'effigie de son histoire. De quoi te souviens-tu de 1974 ? Son sourire gourmand d'une confiance encore collée aux lèvres. Que deviendra sa boutique dans dix ans ? Dernière, aux portes de l'oubli. Je ne sais pas ce qui m'attire ici, cette ville me fascine. Quelque chose m'appelle, écris, écris ça, maintenant. Serait-ce pour empêcher le temps de filer, pour fixer ce qui reste, pour comprendre comment le destin de deux peuples peut ainsi basculer en quelques heures ? Ce pays s'échappe, Nicosie se désagrège, grains de sable trop fin, trop blanc, entre mes doigts. Je suis aveuglée par la lumière des matins, la liquidité du ciel. Comment vivre à côté de la Green Line ? Comment vivre comme si de rien n'était ? Tout semble figé, immobile. Parfois une vieille carcasse de voiture en bord de rue dont les pneus n'ont plus frôlé le bitume depuis trente-huit ans.
Il y a toutes ces fenêtres éteintes, cette absence collée dans la peinture. Il y a la mort comme un souffle passé sur la ville en 1974. Nicosie, tes ruelles anciennes, tes odeurs de moisi, tes bâtisses fières dans le ciel sans pluie. Quelque chose d'indicible, cette nostalgie, comme si la ville attendait encore le retour de ses disparus. Le présent est comme figé dans le passé de cet été là , quand les troupes turques ont envahi le nord de Chypre. Les traces de balles sur les vieilles pierres, les bidons d'essence peints en bleu et blanc. Le vert militaire. Il y a ce barbier, Christo, 78 ans, il n'a pas bougé depuis quatre ou cinq décennies et ce matin il a posé devant l'appareil photo, fier, derrière lui son évier blanc à l'effigie de son histoire. De quoi te souviens-tu de 1974 ? Son sourire gourmand d'une confiance encore collée aux lèvres. Que deviendra sa boutique dans dix ans ? Dernière, aux portes de l'oubli. Je ne sais pas ce qui m'attire ici, cette ville me fascine. Quelque chose m'appelle, écris, écris ça, maintenant. Serait-ce pour empêcher le temps de filer, pour fixer ce qui reste, pour comprendre comment le destin de deux peuples peut ainsi basculer en quelques heures ? Ce pays s'échappe, Nicosie se désagrège, grains de sable trop fin, trop blanc, entre mes doigts. Je suis aveuglée par la lumière des matins, la liquidité du ciel. Comment vivre à côté de la Green Line ? Comment vivre comme si de rien n'était ? Tout semble figé, immobile. Parfois une vieille carcasse de voiture en bord de rue dont les pneus n'ont plus frôlé le bitume depuis trente-huit ans.
- SANS AUTORISATION
 Tels deux chats de gouttière à la tombée de la nuit, Annick et moi nous faufilons entre les sacs de sable et les bidons remplis de béton de la Green Line. Il fait tiède, nous sommes en t-shirt, déjà plus de trente degrés aux premiers jours de mai. Silencieuses. Ne pas nous faire repérer. Le moindre craquement de porte ou bruissement de paroles échangées me fait sursauter. Nous gagnons les abords des points d'observation. Ici c'est un territoire de silence. Dans l'épaisseur morbide de l'air je tente de sentir, de comprendre ce que cela peut être de toucher, de longer cette ligne depuis plus de trente huit ans avec des bottes kaki et un fusil à l'épaule. Juste un peu plus loin, de l'autre côté de cette fausse frontière, de cette séparation improvisée dans l'urgence, les militaires veillent. Quelles sont leurs blagues pour tromper l'attente et la fatigue ? Y a-t-il encore des questions dans leurs yeux rivés sur le sud de Nicosie ? Qu'est-ce que dresser un mur veut dire ? Je pourrais m'extraire de ce boyau clandestin et me hisser sur cette ligne. Lentement, funambule, je glisserais sur la pliure point de mire des deux regards, de là -haut j'apercevrais la mer au nord et la mer au sud. Une île enfin réunie. Une île comme un livre que je referme mais dont il manque la fin.
Tels deux chats de gouttière à la tombée de la nuit, Annick et moi nous faufilons entre les sacs de sable et les bidons remplis de béton de la Green Line. Il fait tiède, nous sommes en t-shirt, déjà plus de trente degrés aux premiers jours de mai. Silencieuses. Ne pas nous faire repérer. Le moindre craquement de porte ou bruissement de paroles échangées me fait sursauter. Nous gagnons les abords des points d'observation. Ici c'est un territoire de silence. Dans l'épaisseur morbide de l'air je tente de sentir, de comprendre ce que cela peut être de toucher, de longer cette ligne depuis plus de trente huit ans avec des bottes kaki et un fusil à l'épaule. Juste un peu plus loin, de l'autre côté de cette fausse frontière, de cette séparation improvisée dans l'urgence, les militaires veillent. Quelles sont leurs blagues pour tromper l'attente et la fatigue ? Y a-t-il encore des questions dans leurs yeux rivés sur le sud de Nicosie ? Qu'est-ce que dresser un mur veut dire ? Je pourrais m'extraire de ce boyau clandestin et me hisser sur cette ligne. Lentement, funambule, je glisserais sur la pliure point de mire des deux regards, de là -haut j'apercevrais la mer au nord et la mer au sud. Une île enfin réunie. Une île comme un livre que je referme mais dont il manque la fin.
- LES STIGMATES DE LA GUERRE
- UNE NUIT DANS LA VOITURE
 Je m'appelle Hussein Pil, je suis chypriote turc et je viens d'avoir 80 ans. Le 20 juillet 1974 en quelques heures j'ai dû quitter la ville de Paphos où j'ai grandi et où mes enfants sont nés. J'ai dû m'exiler au nord, tout abandonner, ma maison, mes oliviers, mes meubles, mes photos de famille sur les murs, les souvenirs qui avaient poussé partout. Mais moi, j'avais la vie sauve. Ce soir, 22 avril 2003, je suis venu à Nicosie, au bord de la Green Line, avec mon fils Guner, il avait quelques mois quand nous avons dû fuir en 1974. Je lui ai demandé de m'accompagner car demain les autorités ouvriront le premier check point de l'île. Je sais que nous serons des centaines, des milliers peut-être à vouloir retourner sur le lieu de notre vie d'avant. Ce soir malgré mon dos fatigué, je vais dormir dans la voiture et demain je traverserai à pied la Green Line. Je veux être là , un des premiers à mettre le pied de l'autre côté, après vingt-neuf ans, aux aurores demain matin. Qu'est devenue ma maison ? Mes oliviers ont-ils été coupés ? Que reste-t-il des jeux des enfants dans la petite cour défraîchie ? Et la tombe de ma femme au cimetière du village ? C'est comme si l'hier de 1974 n'avait pas pris une ride dans ma tête. « I feel like I'm living a dream » dit-il alors qu'il traverse la Green Line à Ledras Palace.
Je m'appelle Hussein Pil, je suis chypriote turc et je viens d'avoir 80 ans. Le 20 juillet 1974 en quelques heures j'ai dû quitter la ville de Paphos où j'ai grandi et où mes enfants sont nés. J'ai dû m'exiler au nord, tout abandonner, ma maison, mes oliviers, mes meubles, mes photos de famille sur les murs, les souvenirs qui avaient poussé partout. Mais moi, j'avais la vie sauve. Ce soir, 22 avril 2003, je suis venu à Nicosie, au bord de la Green Line, avec mon fils Guner, il avait quelques mois quand nous avons dû fuir en 1974. Je lui ai demandé de m'accompagner car demain les autorités ouvriront le premier check point de l'île. Je sais que nous serons des centaines, des milliers peut-être à vouloir retourner sur le lieu de notre vie d'avant. Ce soir malgré mon dos fatigué, je vais dormir dans la voiture et demain je traverserai à pied la Green Line. Je veux être là , un des premiers à mettre le pied de l'autre côté, après vingt-neuf ans, aux aurores demain matin. Qu'est devenue ma maison ? Mes oliviers ont-ils été coupés ? Que reste-t-il des jeux des enfants dans la petite cour défraîchie ? Et la tombe de ma femme au cimetière du village ? C'est comme si l'hier de 1974 n'avait pas pris une ride dans ma tête. « I feel like I'm living a dream » dit-il alors qu'il traverse la Green Line à Ledras Palace.
- VILLE FANTÀ”ME
 Il y a ces lieux qui vous sautent à la gorge. Ici à Varosha, la vie n'a jamais repris son cours. La ville désertée épouse les contours de Famagusta. Dans les années 70 le paradis balnéaire de la haute société. Suites de luxe réservées trente ans à l'avance. Vue turquoise à perte d'horizon. Varosha en quelques heures a tout perdu. Les courants d'air, trente-huit ans plus tard, la traversent toujours. La population, majoritairement grecque et britannique, a fui pendant l'invasion de 1974. La ville morte est depuis sous contrôle de l'armée turque. Interdiction d'y pénétrer, interdiction de prendre des photos. Seul un groupe très restreint de fonctionnaires de l'ONU peut y accéder. Leur trajectoire est minutieusement dessinée. Chaque regard est contrôlé, en atteste sur la plage la guérite du militaire turc. Varosha c'est le silence du béton mêlé au ressac des vagues. Le linge aux fenêtres, les cages d'escaliers des hôtels prêtes à s'effondrer, les grillages accrochés au bleu du ciel, la béance du vide, l'angoisse des traces profondes de la division d'un monde. Et à côté, juste là , le sable blanc de la plage caresse les jambes des touristes et sous le soleil le cristal des vagues scintille. Trop. Est-ce possible ? Varosha pris en otage, rançon qui se fait attendre et qui remue les esprits. Dans les garages les voitures neuves n'ont jamais roulé, les réfrigérateurs ont pourri, les lits n'ont pas été défaits. Que reste-t-il du passé de chacun ? Un jour les façades emportées par la mer, le vent brisant les dernières vitres, arrachant les derniers souvenirs. Qui un jour oserait revivre ici ?
Il y a ces lieux qui vous sautent à la gorge. Ici à Varosha, la vie n'a jamais repris son cours. La ville désertée épouse les contours de Famagusta. Dans les années 70 le paradis balnéaire de la haute société. Suites de luxe réservées trente ans à l'avance. Vue turquoise à perte d'horizon. Varosha en quelques heures a tout perdu. Les courants d'air, trente-huit ans plus tard, la traversent toujours. La population, majoritairement grecque et britannique, a fui pendant l'invasion de 1974. La ville morte est depuis sous contrôle de l'armée turque. Interdiction d'y pénétrer, interdiction de prendre des photos. Seul un groupe très restreint de fonctionnaires de l'ONU peut y accéder. Leur trajectoire est minutieusement dessinée. Chaque regard est contrôlé, en atteste sur la plage la guérite du militaire turc. Varosha c'est le silence du béton mêlé au ressac des vagues. Le linge aux fenêtres, les cages d'escaliers des hôtels prêtes à s'effondrer, les grillages accrochés au bleu du ciel, la béance du vide, l'angoisse des traces profondes de la division d'un monde. Et à côté, juste là , le sable blanc de la plage caresse les jambes des touristes et sous le soleil le cristal des vagues scintille. Trop. Est-ce possible ? Varosha pris en otage, rançon qui se fait attendre et qui remue les esprits. Dans les garages les voitures neuves n'ont jamais roulé, les réfrigérateurs ont pourri, les lits n'ont pas été défaits. Que reste-t-il du passé de chacun ? Un jour les façades emportées par la mer, le vent brisant les dernières vitres, arrachant les derniers souvenirs. Qui un jour oserait revivre ici ?
- FALLING DEBRIS
- RECOUDRE LEURS VIES
 A cette heure encore il fait si chaud L'air colle à sa vieille peau Elle et sa dentelle s'assoient sur le trottoir Elle aime la vie du dehors le soir Il y a du monde presque comme autrefois Je ne suis plus seule tu vois Xenia Sa vie coupée en deux avec la Green Line au milieu Le nord c'était avant c'était avec eux Le sud solitaire l'a recueillie depuis Et ses enfants sont partis ailleurs gagner leur vie En Angleterre En Afrique du sud et à Vancouver Elle entend leur voix parfois Mais ses petits-enfants de là -bas Jamais ne grandiront ici Elle s'attèle malgré tout à recoudre leurs vies Ce soir il fait encore trop chaud De trop de solitude s'assèche sa vieille peau Elle s'installe avec sa chaise sur le trottoir Là où elle aime attendre les bruits du soir. Textes : Aude Lafait Photographies : Annick Mertens.
A cette heure encore il fait si chaud L'air colle à sa vieille peau Elle et sa dentelle s'assoient sur le trottoir Elle aime la vie du dehors le soir Il y a du monde presque comme autrefois Je ne suis plus seule tu vois Xenia Sa vie coupée en deux avec la Green Line au milieu Le nord c'était avant c'était avec eux Le sud solitaire l'a recueillie depuis Et ses enfants sont partis ailleurs gagner leur vie En Angleterre En Afrique du sud et à Vancouver Elle entend leur voix parfois Mais ses petits-enfants de là -bas Jamais ne grandiront ici Elle s'attèle malgré tout à recoudre leurs vies Ce soir il fait encore trop chaud De trop de solitude s'assèche sa vieille peau Elle s'installe avec sa chaise sur le trottoir Là où elle aime attendre les bruits du soir. Textes : Aude Lafait Photographies : Annick Mertens.